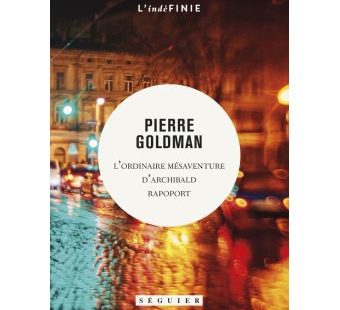Pierre Goldman : dès l’évocation de ce nom nous reviennent en mémoire les bribes d’une histoire déjà ancienne, celle des années 1970 et de ces jeunes exaltés qui, n’ayant trouvé ni réponse ni réconfort à leurs questionnements sur la société post-soixante-huitarde, sont allés faire la révolution en Amérique latine.
Quand on observe l’itinéraire de Pierre Goldman, on se rend compte que sa vie a été placée sous le signe de la violence, du berceau (dans lequel ses parents résistants FTP-MOI cachaient des armes) au tombeau (son assassinat par balles en septembre 1979).
Entre-temps, il est tombé amoureux des rythmes cubains et de la salsa, a frayé avec des voyous guadeloupéens, a revendiqué trois braquages à main armée, a été accusé d’un double meurtre, est devenu une icône malgré lui et a écrit deux livres avant de mourir à l’âge de 35 ans abattu par des tueurs d’extrême droite.
Nous connaissons bien entendu ses Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France, récit publié au Seuil en 1975. Le livre a ému des milliers de personnes et jeté la lumière sur son sort, celui d’un homme qui clame son innocence et se sert de sa plume pour « commenter son dossier d’instruction », un fait unique dans le monde judiciaire.
Libéré en mai 1976 après six années passées à Fresnes, il ne lui reste que trois ans d’existence.
En 1977 paraît un nouveau livre, L’ordinaire mésaventure d’Archibald Rapoport. Refusé par l’éditeur de Souvenirs obscurs, il est finalement publié chez Julliard. Le refus de Claude Durand a été motivé par la peur, peur de ce qu’il considère comme un brûlot, la confession de crimes alors que tout le monde a encore en tête son livre précédent dans lequel il apportait les preuves de son innocence.
Cela fait quarante ans aujourd’hui que Pierre Goldman a disparu. L’eau a coulé sous les ponts et les passions se sont émoussées autour de « l’affaire Goldman ». Les éditions Séguier ont eu la bonne idée sinon le courage de republier L’ordinaire mésaventure d’Archibald Rapoport assorti d’une préface de Philippe Gumplowicz, préface dédiée à Christiane, la veuve de Pierre, et qui rend un bel hommage à l’écrivain que fut Goldman.
Il suffit d’un livre marquant pour construire une œuvre et laisser une trace indélébile dans la littérature. Pierre Goldman en a produit deux : si le premier a été écrit avec ses tripes, retraçant le parcours d’un homme que les médias et la police ont désigné d’emblée comme coupable, véritable témoignage coup-de-poing, le second est né de sa pure imagination.
D’aucuns, lors de la sortie du livre en 1977, se sont récriés devant ce texte qui leur donnait trop d’indices croyaient-ils sur la personnalité de l’auteur et ne voulaient pas le considérer comme un écrivain. Non, Goldman n’est qu’un intellectuel d’extrême gauche braqueur à l’occasion et pourquoi pas meurtrier ? Jamais nous ne lui décernerons l’honneur de le faire entrer dans le monde de la littérature. Qu’il demeure dans les tréfonds de la mémoire collective, martyr ou assassin, peu nous importe, mais auteur, jamais !
Et pourtant… Si Archibald Rapoport ressemble comme un frère à Pierre Goldman, il n’en est pas le miroir, loin s’en faut, même s’il lui prête ses obsessions : la judéité, la Shoah, l’antisémitisme, l’amour des musiques cubaines. D’ailleurs, si l’on pousse les comparaisons, on peut remarquer qu’Archibald, comme Pierre, est accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis mais qu’on lui attribue.
L’histoire ? Archibald Rapoport est orphelin. Son père, Chmoul, a été guillotiné sous l’Occupation après l’attaque d’un local de la Milice ; quant à sa mère, Malka, elle s’est donné la mort en s’égorgeant après avoir poignardé un officier SS avec un mohel (le couteau dont se sert le rabbin pour la circoncision, tout un symbole…). Avant de mourir, elle « parle dans la bouche » de son bébé : il n’aura pas la faculté de rire (il pourra néanmoins sourire) ni de pleurer.
Archibald est élevé par sa tante Liouba, une ancienne prostituée. Il abandonne la religion et entame sa semaine sanglante (il se reposera le septième jour) au cours de laquelle il tue quatre policiers, deux magistrats et un avocat. Au terme de son épopée sanglante, il se constitue prisonnier mais lorsqu’on l’interroge sur ses motivations, il ne peut que répondre qu’il a tué « pour écrire ».
On peut interpréter ce texte comme un chant rituel (Archibald s’exprime en chantant lors de ses aveux) dédié au peuple juif. Les parents d’Archibald sont morts mais n’ont pas été immolés ; loin d’être des victimes sacrificielles, ils ont agi avant de mourir. Leur enfant ne peut verser de larmes puisque cela lui est interdit. Il ne peut donc les pleurer, ni eux, ni les millions de victimes de la Shoah. Sa seule réponse à la violence de l’Histoire sera de semer lui aussi la mort, une mort aveugle, comme celle que les SS ont infligée à tant de familles juives.
Pierre Goldman décrit le monde policier et la magistrature avec une ironie cruelle (on pense à Albert Cohen et sa description de la Société des Nations quand Goldman met en scène la magistrature et ses affidés) mais tous ces officiers assermentés n’avaient-ils pas été complices de l’occupant quelques années auparavant ? Rien n’a changé depuis la fin de la guerre et l’antisémitisme est toujours présent dans les bureaux de la police judiciaire comme dans les prétoires. Il tourne aussi en dérision ces journaux dont l’orientation politique dicte le contenu.
Alors oui, Archibald va donner à écrire son histoire parce que l’écriture et la transmission appartiennent à l’histoire juive. Écrire pour ne pas oublier, écrire pour exister, écrire pour perpétuer le souvenir de ceux qui ne sont plus là pour témoigner.
Une fois sa « mission » accomplie, il retrouve sa faculté de pleurer et peut partir en paix.
Cette histoire fantasmagorique est servie par une écriture époustouflante, une fable à la fois cruelle et lucide.
Espérons que l’exhumation de cette œuvre donnera l’occasion à des milliers de lecteurs de découvrir ou redécouvrir ce que fut Pierre Goldman : un grand écrivain, tout simplement…
Pierre Goldman, L’ordinaire mésaventure d’Archibald Rapoport, préface de Philippe Gumplowicz, Séguier, coll. « L’indéFINIE », 18 avril 2019, 208 pages, 20 euros.